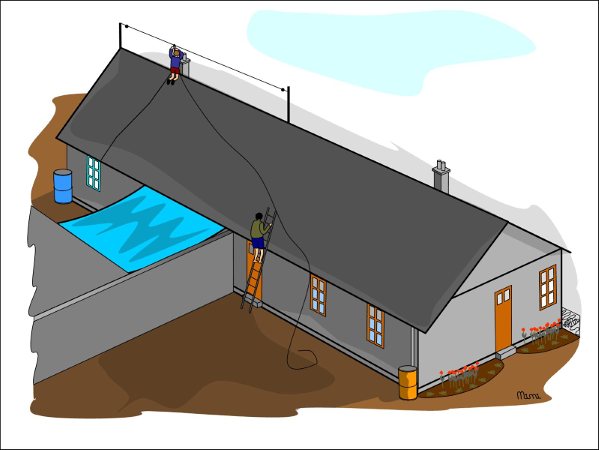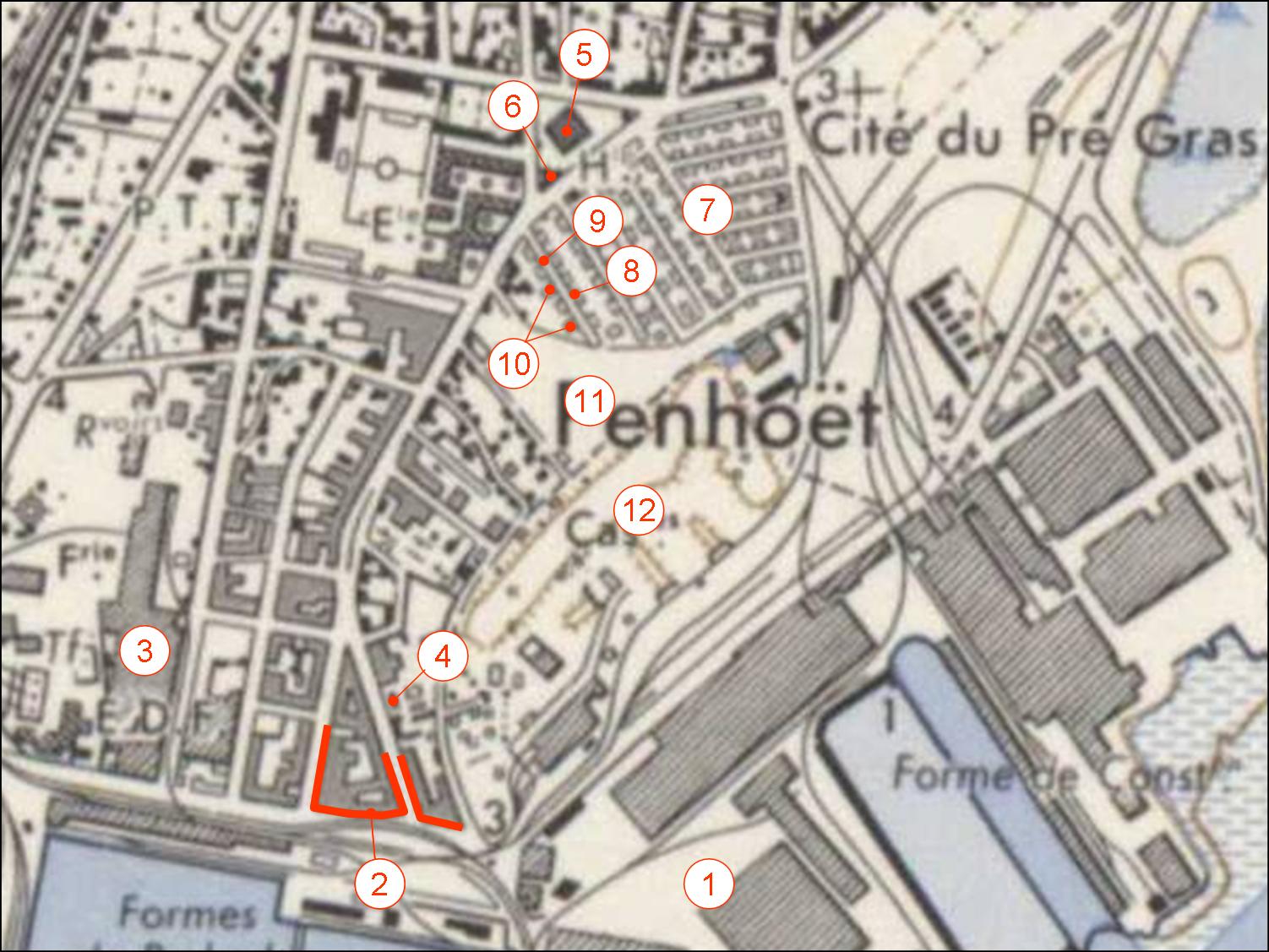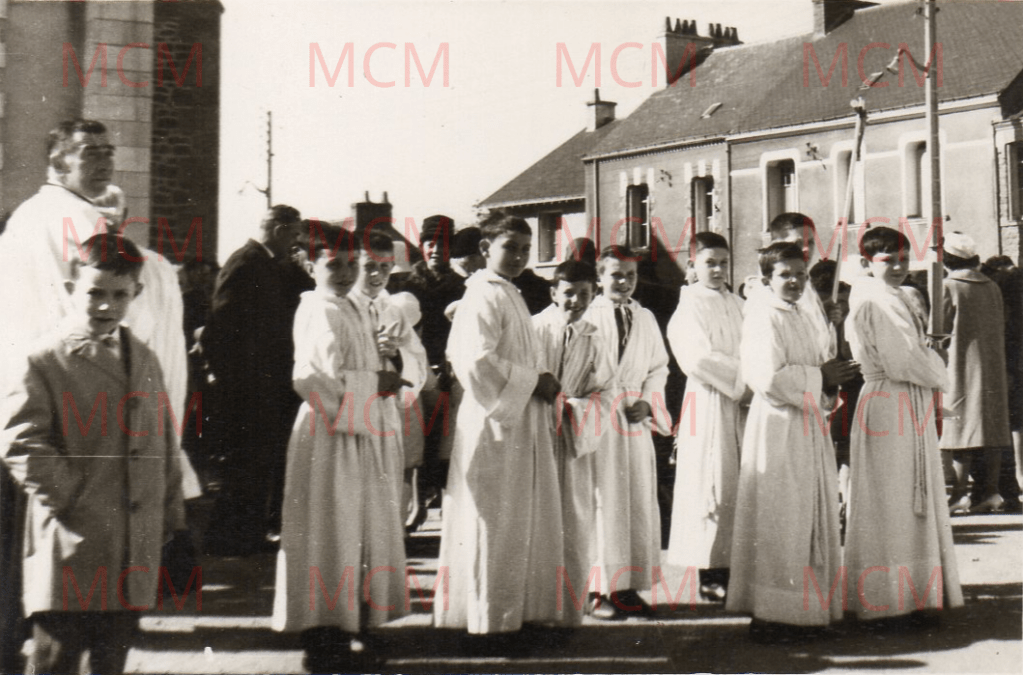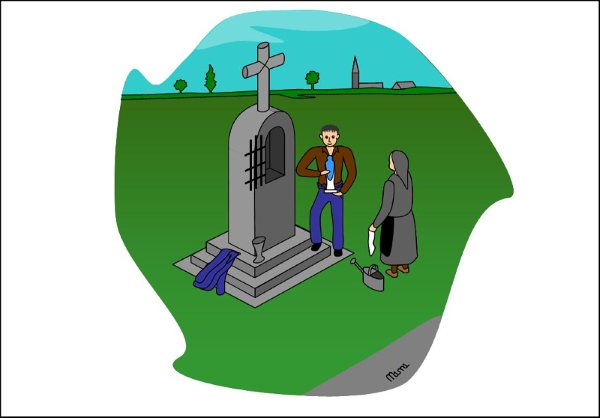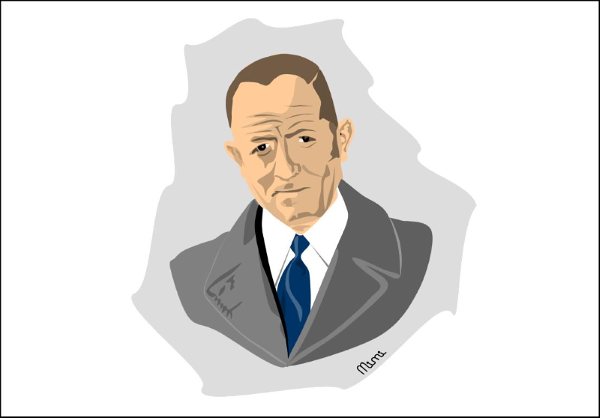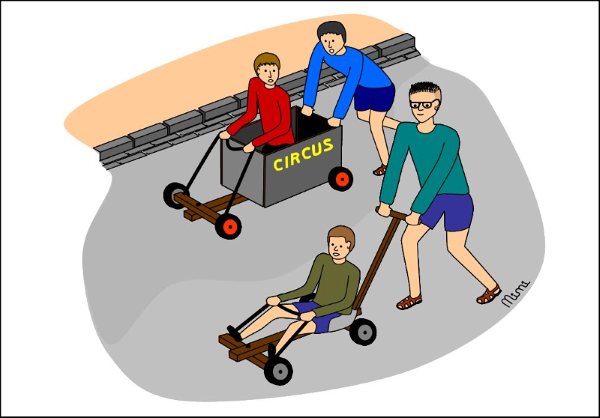Johnny
J’avais reçu un appel téléphonique assez laconique dès l’embauche :
« Monsieur Mahé, on vous envoie un nouveau stagiaire.
– Pardon ! Mais je n’ai rien demandé ! Je n’ai rien préparé ! Attendez ! Mais cela se prépare l’arrivée d’un jeune !
– Ecoutez ! On ne peut pas vous expliquer, on agit dans l’urgence, faites pour le mieux. Son professeur va prendre contact avec vous. » Et mon interlocuteur raccroche.
J’étais sidéré. J’avais l’habitude de choisir les jeunes avec qui je travaillais, condition sine qua non pour que tout se passe bien, car mon travail, c’était d’abord que l’atelier gagne de l’argent grâce à une meilleure productivité, à une meilleure qualité. Je n’étais pas, à priori, un formateur. J’étais là pour mettre le jeune en situation et l’aider à accomplir une tâche précise inscrite dans un plan de développement de l’atelier et prévue depuis de longs mois dans ses moindres détails.
Le téléphone sonna de nouveau :
« Monsieur Mahé, bonjour, Monsieur L. professeur du lycée technique de S. D’après ce que l’on m’a dit vous allez accueillir Johnny.
– Pour tout vous dire, je n’ai pas eu le choix. On vient de me le dire, il y a quelques minutes.
– Je sais, tout ça s’est fait très vite, nous avions un peu de mal à lui trouver un maître de stage…Johnny* est un très gentil garçon…il est un peu particulier…un peu aux antipodes de ce que vous recherchez habituellement d’après ce que m’a dit votre direction.
– Aux antipodes ? Je ne comprends pas.
– Ecoutez, vous allez voir. Il passe son bac pro cette année… »
Une ombre s’était profilée à la porte d’entrée du bureau légèrement entrouverte. Un violent coup de pied l’ouvrit complètement. Alors il me sembla qu’un géant, qu’une montagne venait d’entrer dans le bureau.
C’était un garçon d’un mètre quatre vingt quinze au moins, aux larges épaules. Les cheveux rasés, des piercings sur le lobe et le pourtour du pavillon de l’oreille. Un autre à chaque sourcil ainsi qu’à la lèvre. Un pantalon et une veste de cuir, des rangers complétaient la panoplie.
« C’est vous Mahé ? »
Pendant quelques secondes je restai abasourdi, j’entendis au téléphone :
« Allo Monsieur Mahé vous m’entendez ?
– Oui, oui …Votre garçon…heu… vient d’arriver, je vous rappelle un peu tard… » Et je raccrochai
Je savais que les premières secondes étaient capitales car le rapport de force était évident.
« Veuillez immédiatement sortir, frapper et attendre que je vous dise d’entrer. C’est compris ! » Dis-je d’une voix ferme.
Il s’exécuta en maugréant.
« Entrez !
– Asseyez-vous ! Lui dis-je, nous allons mettre les points sur les « i » tout de suite. Si vous venez travailler avec moi, il y a des règles à respecter. Elles sont communes à tous les stagiaires qui rentrent dans ce bureau, techniciens ou élèves ingénieur. On m’appelle « monsieur » et on me dit « vous ». Est-ce clair ?
– Oui
– Oui qui ?
– Oui, monsieur.
– Bien ! Je viens juste d’être prévenu de votre arrivée. Je n’ai rien préparé. Vous savez dessiner?
– Ben oui, si je prépare un bac pro, je sais dessiner, dit-il en parlant avec cette diction si caractéristique des jeunes de banlieues. Mais comment voulez-vous que je dessine, ici, il n’y a pas de table à dessin !
– Il n’est pas nécessaire d’avoir une table à dessin. » lui répondis-je sèchement.
– A ben, c’est nouveau ça, moi, je ne dessine que sur une table à dessin !
– Vous allez me faire un avant-projet d’un support d’un instrument de mesure. C’est un travail que je comptais donner à un étudiant en mesure physique. Vous vous sentez capable ?
– Vous me demandez d’inventer un support d’un instrument de mesure ? Ben oui je suis capable ! Je vous en fais tous les jours des supports d’instruments de mesure. »
Alors je lui expliquais posément ce que j’attendais de lui, définissais son plan de travail. A la fin je lui dis :
« Vous allez vous installer à ce bureau et écrire tout ce que je viens de dire. » Il n’avait pris, bien entendu, aucune note.
Il s’exécuta. Quelle galère, pensai-je, un mois, un mois à cohabiter avec cet olibrius. J’étais très en colère. J’avais des objectifs à atteindre et j’avais le sentiment que l’on se moquait de moi. Le temps passé avec un jeune était important et me demandait toujours un surcroit de travail considérable surtout au début. Pourquoi lui ai-je donné ce genre de projet ? C’est évident il n’en n’est pas capable !
Dans le milieu de la matinée, je suis allé voir où il en était avec ses travaux d’écriture. « Fenêtre prend un accent circonflexe sur le « e » avant le « t » dis-je négligemment.
– Voilà bien longtemps que l’on ne met plus les accents circonflexes, ils ne servent à rien, me dit-il avec aplomb.
– Oh ! Vous êtes aussi un pro de l’orthographe, c’est génial ! » Dis-je d’un ton ironique.
Il me présenta ses travaux, l’écriture était malhabile, grossière. C’était bourré de fautes d’orthographe mais l’essentiel des idées étaient présentes et ordonnées.
« Il n’est pas trop sot, me dis-je, voyons ce qu’il sait faire en dessin. »
Avisant une pièce mécanique qui trainait sur un meuble :
« Vous allez me représenter cette pièce avec les cotations.
– Sans table à dessin ?
– Au compas, à la règle et à l’équerre, vous verrez cela se fait très bien.
Il retourna à son bureau en maugréant.
« Ce n’est pas un mauvais bougre, pensai-je, mais mon dieu quelle allure ! »
Le jour suivant, il me rendit son dessin.
« Vous vous dites dessinateur ! Vous ne savez même pas coter une pièce ! Comment voulez- vous continuez ? Ce n’est pas possible ! »
Avant même qu’il ouvrit la bouche je lui dis :
« Taisez-vous ! Voilà ce que l’on va faire, tous les soirs après la débauche, nous allons revoir ensemble les bases du dessin industriel. On commence ce soir c’est compris! »
Contre toute attente j’entendis un
« Oui, Monsieur.
– Vous allez maintenant, à partir du cahier des charges, réaliser une série de croquis à main levée, cherchez la forme du support qui correspond le mieux aux différentes fonctionnalités. Vous présenterez votre travail la semaine prochaine devant un groupe d’ingénieurs.
– Un groupe d’ingénieurs ! Je dois leur présenter mon travail !
– C’est un challenge pour vous, à vous de le relever, vous pouvez abandonner.
– Non, non je vais le faire. »
Toute la semaine, Johnny travailla d’arrache-pied, Il me plaisait de le voir, griffonner, gommer, dessiner, raturer, s’escrimer. Tous les soirs nous révisions ensemble les règles du dessin industriel ce qui m’obligeait à potasser mon cours à la maison.
Pour cette présentation, j’avais sollicité la présence de quelques responsables et malgré leur emploi du temps bien rempli tous vinrent. Je les avais prévenus du caractère atypique du personnage mais je comptais sur leur présence pour créer une émulation, exacerber son ego pour qu’il puisse se dépasser sur ce projet.
La réunion avait lieu à neuf heures et lorsque je vis entrer Johnny dans mon bureau, il avait troqué sa tenue de motard contre un jean, chemise, pull et chaussures de ville mais il avait gardé ses piercings.
Johnny présenta les résultats de ses cogitations. Il fut bien sûr un peu maladroit, certains de ses croquis étaient un peu futuristes mais chacun s’intéressa à son travail. Les commentaires furent nombreux, il prenait des notes, acquiesçait, argumentait, se sentait important.
Pour lui montrer les avantages que l’on pouvait tirer d’une bonne scolarité. Sans un mot, sans lui faire la leçon, je l’emmenais dans le fond d’un navire, dans les ballasts et les caisses , avec les peintres, dans une atmosphère polluée par la poussière et l’odeur qui vous prennent à la gorge, puis, immédiatement pour accentuer le contraste, dans l’atmosphère calme et feutrée des bureaux d’études et de recherche développement.
Le reste du stage fut agréable. Je ne baissais pas ma garde mais je laissais une certaine connivence s’établir. Son professeur vint lui rendre visite et fut très étonné de son changement d’attitude.
On fit réaliser son projet et il dirigea les premiers essais dans l’atelier. Nous avions convié les principaux responsables du département, quelques ouvriers et son professeur. Ce fut un succès et les participants le congratulèrent.
Le mois passa, vint le jour du départ, ce soir là, Johnny restait à son bureau, il était silencieux, il n’avait pas envie de partir. Lorsqu’enfin il se décida, je lui souhaitais bonne chance mais j’avais un petit pincement au cœur. En le regardant remonter l’allée centrale de l’atelier je me disais :
« Tu vas certainement retrouver les codes de l’environnement de ton lycée avec dans la plupart des cas un nivellement par le bas. Tu as vraiment un réel potentiel, dommage. »
Trois années passèrent, un soir, je vis entrer dans le bureau un grand gaillard, je reconnus la tenue de travail d’une entreprise sous-traitante :
« Oui c’est pourquoi ?
– Bonjour, Monsieur Mahé, vous ne me reconnaissez pas ?
– Johnny ! Mon Dieu Johnny ! »
Il avait vraiment changé, plus de piercings, les cheveux courts, le sourire éclatant des garçons croyant à leur avenir. Nous échangeâmes longuement. Il m’apprit, entre autres, qu’il avait été reçu à son BAC puis passé son BTS, qu’il était contremaître dans une entreprise sous-traitante et allait passer dans quelques mois chef de chantier.
Ce jour là, après son départ, j’avais le sentiment d’avoir, peut-être, aidé à la remise à l’eau d’une étoile de mer que les vagues avaient rejetée loin sur la plage…
* Prénom inventé.